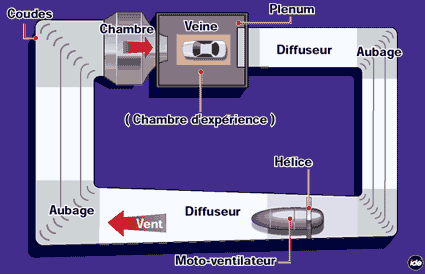
AERODYNAMISME ET MOUVEMENT
L’aérodynamique
est une branche de la mécanique des fluides qui s'intéresse aux
phénomènes résultant des mouvements relatifs des corps par
rapport à l'air. Ici, l’étude du déplacement d’un aéroglisseur
constituera notre exemple d'application de l'aérodynamique.
Pour étudier ce déplacement, on peut tester l’appareil
dans une soufflerie aérodynamique. Une soufflerie aérodynamique
est un dispositif expérimental utilisé en aérodynamique pour
simuler les conditions rencontrées par tout corps se déplaçant
dans l'air. Un corps étudié dans une soufflerie est placé,
immobile, dans un écoulement artificiel d'air ou de gaz.
Exemple :
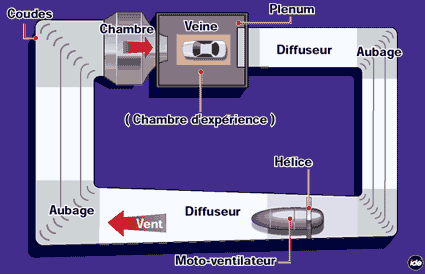
Schématisation d’une soufflerie
Par exemple, voici les résultats obtenus pour le test de la carrosserie d’une voiture dans une soufflerie aérodynamique :
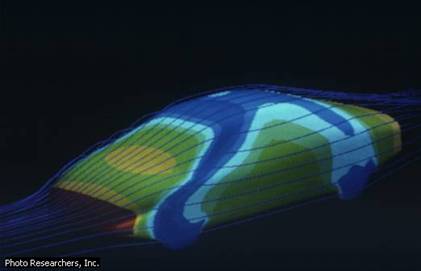
Simulation
en CAO : La répartition de la poussée du vent sur la
carrosserie d'une voiture est simulée sur ordinateur dans le
cadre de la conception assistée par ordinateur (CAO). Les zones
rouges représentent les zones de poussée élevée, les zones
bleues celles de faible poussée.
Le mouvement
relatif de l’air ambiant et l’action du fluide survolé
sont à l’origine des forces et moments agissant sur un aéroglisseur.
Un moment d’une force par rapport à un point quelconque O d’un
objet, ici l’aéroglisseur, est le produit de la force par
le bras de levier de cette force : travail de cette force.
Les mouvements de l’air ambiant peuvent être déterminés
avec précision par des calculs ou des essais en soufflerie. En
revanche, l’action du fluide survolé est difficile à déterminer,
car ils dépendent du contact ou non des jupes de l’aéroglisseur
avec la surface survolée.
1) Notion d’angle d’incidence et de dérapage :
D’ailleurs,
les études aérodynamiques faites sur les avions donnent les mêmes
résultats que pour les aéroglisseurs, à la différence que la
surface survolée ne se trouve qu’à quelques centimètres
en dessous de l’aéroglisseur.
On notera i et j
les angles d’incidence et de dérapage. Pour un aéroglisseur,
i varie entre +5° et –5°, ce qui s’explique par la présence
proche du sol. En effet, pour un avion, on recueille des résultats
de +10° à –25°. Et l’angle de dérapage j varie de
-180° à +180°, ce qui signifie qu’un aéroglisseur peut
effectuer un demi-tour complet sur soi en une seule manœuvre,
car l’angle a une valeur totale de 360°.
Exemple :

Schématisation de l’angle d’incidence
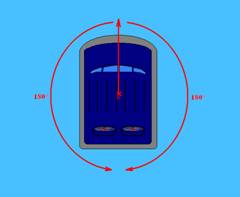
Schématisation de l’angle de dérapage
Définition
de l’angle d’incidence : c’est l’angle
formé par la corde de profil de l’aéroglisseur, c’est-à-dire
la droite horizontale passant par le centre de gravité G de l’aéroglisseur,
et le vecteur v de vent relatif. Cet angle est également appelé
angle d’attaque. Habituellement, un avion décroche lorsque,
à vitesse constante, l’angle d’incidence dépasse 5°,
augmentant ainsi la portance et rendant ainsi la vitesse
insuffisante. On dit que c’est la couche limite, c’est-à-dire
la couche d’air au contact de l’appareil, qui a décroché.
Ainsi, un aéroglisseur ne peut pas décrocher, car son angle d’incidence
ne dépasse pas +5°.
2) La traînée
:
Définition
de la traînée : c’est la résistance au
passage de l’air, donc parallèle et opposée à l’écoulement.
- La traînée
est proportionnelle au carré de la vitesse.
- La traînée
est proportionnelle à la surface exposée au vent.
- La traînée
est proportionnelle à la masse volumique du fluide
traversé.
- La traînée
est proportionnelle à un coefficient de profil de l'obstacle,
aussi appelé coefficient de traînée : Cx.
Formule de
la traînée :
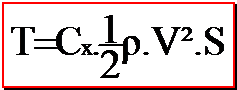
T : Valeur
de la traînée en Newtons (N).
Cx :
Coefficient de traînée, sans échelle
? : masse
volumique du fluide en kg.m3 (1000 kg.m-³
pour l’eau, et 1,225 kg.m-³ pour l'air au
niveau de la mer).
V : Vitesse
relative en m.s-1
S : maître
couple, ou surface exposée au vent en m².
|

3) La portance :
Définition
de la portance : c’est la force qui a tendance
à soulever l’appareil.
La portance est
proportionnelle à la valeur au carré de la vitesse.
La portance est
proportionnelle à la surface, non pas le maître couple, mais
plutôt la surface de l’appareil incliné, projetée à l’horizontale.
La portance est
proportionnelle à la masse volumique du fluide traversé.
La portance est
proportionnelle à un coefficient de profil de l'obstacle, aussi
appelé coefficient de portance : Cz.
Formule
de la portance :
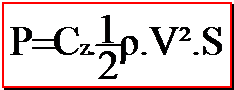
P : Valeur
de la portance en Newtons (N).
Cz :
Coefficient de traînée, sans échelle
? : masse
volumique du fluide en kg.m3 (1000 kg.m-³
pour l’eau, et 1,225 kg.m-³ pour l'air au
niveau de la mer).
V : Vitesse
relative en m.s-1
S : surface
projetée à l’horizontale en m².
Si la corde de
profil de l’aéroglisseur est parfaitement parallèle à l’écoulement
(donc incidence nulle), on obtient un Cz = 0, d'où
l'absence de portance. Ainsi, l’appareil ne s ‘élève
pas.
L’incidence
est limitée par la présence de la surface survolée (eau, sol),
quelques centimètres sous l’aéroglisseur, avec lequel il
ne doit pas entrer en contact, sauf dans des conditions anormales
et exceptionnelles.
La grande
valeur de l’angle de dérapage s’explique, en ce que la
vitesse par rapport au sol est le plus souvent imposée. Ainsi,
la vitesse aérodynamique peut avoir une direction quelconque,
par rapport à l’axe de l’appareil. Il arrive même qu'à
vitesse réduite par rapport au sol, et par fort vent arrière (condition
qui se réalise dans certains cas de manœuvre) la vitesse aérodynamique
soit dirigée d'arrière en avant.
4) Bilan :
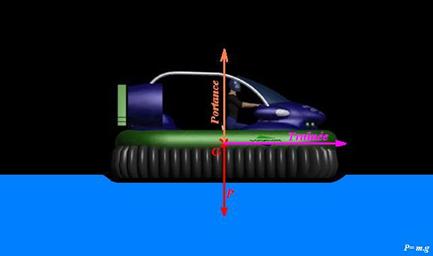
Hypothèses
: solides et liaisons parfaits. Pertes internes (frottements
dans les liaisons) négligées devant les pertes externes. Régime
permanent, vitesse constante, surface survolée horizontale.
Référentiel terrestre : supposé
galiléen.
Choix du système isolé : l’aéroglisseur.